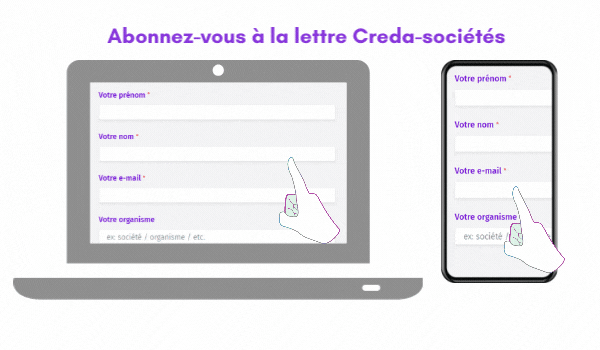Les administrateurs salariés aujourd'hui et demain en France et en Allemagne
Lettre CREDA-sociétés 2018-17 du 7 novembre 2018


Le renforcement de la présence des salariés dans les conseils d’administration, tel qu’il est prévu dans la loi Pacte, est-il une solution pertinente et souhaitable ? Faut-il aller encore plus loin notamment en s’inspirant du modèle allemand qui se caractérise par la place importante réservée aux salariés dans le système de cogestion : la Mitbestimmung ?
En France, la présence d’administrateurs salariés au sein des conseils d’administration a d’abord concerné les sociétés du public, et ce dès 1983. Puis, en 2013, elle a été étendue aux grandes sociétés du secteur privé. Plus précisément, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a inséré à l’article L. 225-27-1 du C. com. (et à l’art. L. 225-79-2 du C. com. pour les SA à directoire et conseil de surveillance) un nouveau régime d’administrateurs représentant les salariés dans les sociétés de grande taille (dont les seuils ont été abaissés par la loi n° 2015-944 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi), selon lequel la désignation d’administrateurs salariés, ayant voix délibérative, est obligatoire..
L’article L. 225-27-1, I, al. 1 du code de commerce énonce :"Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, il est stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des administrateurs représentant les salariés"
Et selon l’article L. 225-27-1, II, al. 1, le nombre des administrateurs représentant les salariés au conseil d’administration est :
- au moins égal à 2 dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs est supérieur à 12 et
- au moins égal à 1 dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs est égal ou inférieur à 12.
Ce dispositif de participation obligatoire des salariés au conseil d’administration s’ajoute aux dispositifs :
- de participation facultative (art. L. 225-27 du C. com.)
- de représentation des salariés actionnaires dans les sociétés cotées (art. L. 225-23 du C. com.).
Il existe cependant des dérogations à l’obligation de désigner des administrateurs salariés (v. notamment art. L. 225-27-1, I, al. 2 et 3 du C. com.) qui visent à éviter un cumul des dispositifs de représentation des salariés dans les conseils d’administration.
Le renforcement de la présence des salariés dans les conseils d’administration en France
La participation obligatoire devrait être prochainement encore renforcée car l’article 62, I du projet de loi Pacte prévoit d’augmenter le nombre des salariés dans les conseils d’administration en modifiant la rédaction de l’article L. 225-27-1, II du C. com. (et celle de l’art. L. 225-79-2, II pour les SA à directoire et conseil de surveillance). Le nombre des administrateurs représentant les salariés au conseil d’administration devrait être :
- au moins égal à 2 dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs est supérieur à 8 et
- au moins égal à 1 dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs est égal ou inférieur à 8.
Le projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 9 octobre 2018 (V. les observations de la CCI Paris Ile de France sur le projet de loi PACTE, notamment p. 38) et pourrait être adopté définitivement en avril 2019.
L’objectif du législateur français est de mieux intégrer les salariés dans la prise de décision au sein des grandes entreprises. A cet égard, il faut relever que le rapport Notat-Senard du 9 mars 2018, qui a servi de base, ou au moins d’inspiration, à l’élaboration du projet de loi Pacte, voulait aller plus loin encore, avec l’introduction d’un troisième administrateur salarié (à partir de treize administrateurs non-salariés).
Les administrateurs salariés sont censés favoriser la recherche d’un équilibre en cas conflit social ou face aux autres administrateurs ; leur présence devrait aussi permettre, comme la mixité, d’élargir les approches des problèmes auxquels sont confrontés les sociétés et leurs administrateurs.
L’influence du dispositif sur l’organisation des sociétés concernées n’est donc pas négligeable et pourrait être positif. Mais celui-ci peut aussi faire l’objet d’un certain nombre de critiques, sous l’angle de la gouvernance (conflits d’intérêtsindépendance et qualification des administrateurs salariés, confidentialité, etc.) ou encore du point de vue de l’attractivité du droit français des sociétés.
Le renforcement de la présence des salariés dans les conseils d’administration, tel qu’il est prévu dans la loi Pacte, est-il alors une solution pertinente et souhaitable ? Faut-il même aller encore plus loin en s’inspirant notamment du modèle allemand qui se caractérise par la place importante réservée aux salariés dans le système de cogestion : la Mitbestimmung ?
La cogestion en Allemagne
L’histoire politique de la cogestion en Allemagne commence avec la « Révolution de Mars » de 1848. Mais le mouvement moderne de la cogestion n’apparaît qu’après la Seconde Guerre mondiale. Ses débuts ont été marqués par une méfiance des syndicats et des puissances occupantes à l’égard des entrepreneurs allemands, méfiance qui concernait en particulier les représentants de l’industrie lourde, dont beaucoup avaient soutenu la dictature nazie. Pour empêcher des nationalisations, mais aussi des démantèlements d’entreprises par les Alliés, les grands industriels sollicitèrent alors les syndicats pour sauver leurs entreprises. Les syndicats exigeaient en retour de participer, sur un pied d’égalité, aux directoires et aux conseils de surveillance. Après quelques résistances de la part du patronat, les syndicats purent imposer la cogestion paritaire dans la loi sur la cogestion dans les entreprises relevant du secteur du charbon et de l’acier du 21 mai 1951 (Montan-Mitbestimmungsgesetz). De nombreuses lois ont ultérieurement étendu ce système aux autres secteurs d’activité, mais aucune ne conféra un aussi grand pouvoir aux salariés que celle de 1951.
La loi relative à l’organisation des entreprises (Betriebsverfassungsgesetz) fut ainsi votée le 11 octobre 1952 (avant d’être remplacée par la loi sur la représentation du tiers des salariés au conseil de surveillance - Drittelbeteiligungsgesetz - du 18 mai 2004) : elle prévoit que dans toutes les sociétés de capitaux de plus de 500 salariés, le conseil de surveillance doit être composé d’un tiers de représentants des salariés. Cette loi instaure la forme la plus faible de participation des salariés.
En outre, la loi sur la cogestion (Mitbestimmungsgesetz) du 4 mai 1976, qui s’applique aux sociétés de capitaux de plus de 2 000 salariés, prévoit une composition paritaire du conseil de surveillance : la moitié des membres représente les associés, l’autre les salariés. Pour résumer ce dispositif, très complexe, la Mitbestimmungsgesetz renforce la présence des salariés au sein du conseil de surveillance avec, notamment, un accès facilité à l’information et au débat ; mais, contrairement au dispositif prévu par la Montan-Mitbestimmungsgesetz, elle ne leur garantit pas la même place qu'aux associés.
Il convient cependant de souligner que dans le régime de la cogestion à l’allemande, les salariés n’ont pas d’influence directe sur la direction de l’entreprise : cogestion, au sens du droit allemand, ne signifie que participation des salariés au contrôle de la société. Pour protéger les intérêts des salariés, il s’agit de prévenir les mauvaises décisions qui menacent leurs emplois.
Cette forme spécifique de cogestion n’existe dans aucun autre État : elle est unique. Le droit allemand prévoit notamment les règles les plus rigides et les plus contraignantes en la matière par rapport aux droits des autres États membres de l’Union européenne, qui ont souvent adopté des solutions très différentes.
Depuis les années 1970, et ces dernières années plus encore, la cogestion, et plus particulièrement la cogestion paritaire, fait l’objet de critiques et d’un vif débat en Allemagne ; de nombreuses propositions de réforme ont été soumises, sans succès cependant pour l’instant. Bien que critiquée, la cogestion est généralement acceptée dans son principe et apparaît généralement légitime et raisonnable ; nul aujourd’hui n’envisage sérieusement de la supprimer. La cogestion paritaire est, en revanche, au centre des controverses. Certains auteurs mettent en cause sa légitimité, d’autres présentent les règles qui l’imposent comme de sérieuses entraves au fonctionnement des sociétés. Il lui est aussi reproché de méconnaître le droit de propriété des associés et d’instaurer un pouvoir excessif des syndicats.
Quoi qu’il en soit, le système allemand de cogestion suppose une certaine maturité des syndicats et des salariés ainsi qu’une culture de dialogue, et sans doute aussi un rapport de forces, qui leur permettent de faire valoir leur point de vue. C’est notamment pour ces raisons qu’il n’est pas certain que ce système soit actuellement transposable dans d’autres pays que l’Allemagne. On l’aura compris, même avec les innovations prévues par le projet de loi Pacte, le droit français des sociétés resterait encore très éloigné de la cogestion à l’allemande.
Katrin DECKERT
Maître de conférences à l’université Paris-Nanterre