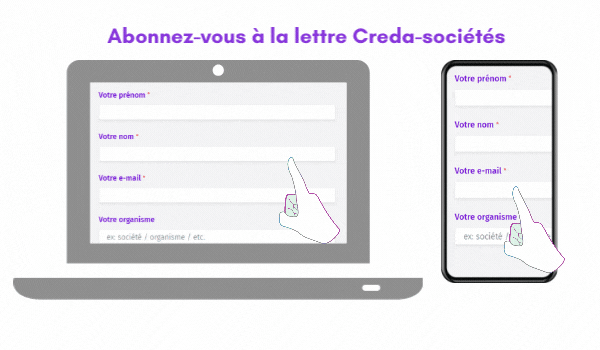Non bis in idem : la chambre criminelle persiste et signe !
Lettre CREDA-sociétés 2017-13 du 4 octobre 2017


La condamnation disciplinaire prononcée par le Conseil des Marchés Financiers (CMF) à l'égard de prestataires d'investissement ayant manqué à leurs obligations professionnelles n'empêche pas les poursuites pour escroquerie devant la juridiction pénale : le CMF ne pouvant être assimilé à une juridiction pénale, le principe non bis in idem ne trouve pas à s'appliquer, estime la chambre criminelle dans un arrêt de cassation en date du 13 septembre 2017.
Depuis la loi n° 89-531 du 2 août 1989, le droit français prévoyait une double répression pénale et administrative en matière d’infractions boursières : délits boursiers réprimés par les juridictions pénales, et manquements administratifs réprimés par la Commission des opérations de bourse puis l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette dualité d’incriminations pouvait donner lieu à un cumul de poursuites et de sanctions pénales et administratives, cumul qui avait été admis par le Conseil constitutionnel dans une décision du 28 juillet 1989.
Ce cumul a été fortement critiqué comme étant contraire à un principe fondamental du droit répressif consacré par des textes internationaux (notamment par l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) : Non bis in idem (nul ne peut être poursuivi et sanctionné à raison de faits déjà jugés de façon définitive).
Mais la Cour de cassation avait d’abord considéré que le cumul des sanctions pénales et administratives des abus de marché échappait à ce principe, en raison d’une réserve formulée par la France quant à l’application du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’Homme, dont l’article 4 consacre le principe Non bis in idem (Crim., 28 janv. 2009, n° 07-81647 ; Com. 8 fév. 2011, n° 10-10.965).
La question a été soumise finalement à la Cour européenne des droits de l’Homme. Aux termes d’un arrêt remarqué du 4 mars 2014 (nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, Grande Stevens c/ Italie), celle-ci a condamné l’Italie du chef d’une violation de l’article 4 du Protocole additionnel n° 7. Considérant que la réserve à l’application dudit protocole invoquée par l’Italie, et comparable à celle formulée par la France, n’était pas valide en raison de sa généralité, la Cour européenne a dit qu’il y avait eu une violation du principe Non bis in idem dès lors que les requérants avaient fait l’objet de sanctions administratives définitives puis de poursuites pénales pour diffusion de fausses informations financières.
Les juridictions répressives françaises ont pourtant refusé, dans un premier temps, d’adopter la solution retenue par la Cour européenne. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), posées dans le cadre de procédures pénales dans lesquelles des personnes étaient poursuivies du chef de délit d’initié (Cass. crim., 17 déc. 2014, 2 arrêts, n° 14-90042 n° 14-90043, et Cass. crim., 4 févr. 2015, n° 14-90049).
Sanctions pénales et administratives : application du principe Non bis in idem
Par sa décision très remarquée du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a exclu à son tour le cumul de poursuites et de sanctions pénales et administratives pour des opérations d’initiés, et plus généralement pour des abus de marché (déc. n° 2014-453/454 QPC, n° 2015-462 QPC). Il est toutefois à noter que, dans cette décision, le Conseil constitutionnel ne s’est pas placé sur le terrain du principe Non bis in idem, mais sur celui du principe français, à valeur constitutionnelle, de nécessité des peines, et a subordonné l’exclusion du cumul de poursuites et de sanctions pénales et administratives à des conditions plus strictes que celles posées par la Cour européenne des droits de l’Homme. En outre, dans une décision rendue quelques mois plus tard, le Conseil constitutionnel (14 janv. 2016 n° 2015-513/514/526 QPC) a approuvé le cumul des poursuites, dans certaines circonstances.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 a cependant été immédiatement et rigoureusement appliquée par les juridictions judiciaires françaises, excluant le cumul de poursuites en matière d’infractions boursières, en se fondant à la fois sur cette décision et sur la portée donnée au principe Non bis in idem par la Cour européenne des droits de l’Homme.
Cette décision du Conseil constitutionnel imposait cependant aussi de procéder à une réforme du cadre français de la répression des abus de marché. C’est ainsi que le nouvel article L. 465-3-6 du Code monétaire et financier, issu de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016, a imposé une option entre la répression pénale et la répression administrative, et instauré un mécanisme d’aiguillage, prévoyant une concertation mutuelle entre le parquet national financier et l’AMF pour choisir la voie répressive appropriée dans chaque cas d’espèce. Le cumul de poursuites et de sanctions est donc désormais neutralisé en matière d’abus de marché. On pouvait cependant se demander si l’exclusion du cumul de poursuites et de sanctions pénales et administratives pour les abus de marché ne conduirait pas à mettre fin aussi au cumul de poursuites et de sanctions pénales et disciplinaires dans d’autres domaines.
Sanctions pénales et disciplinaires : résistance à l’application du principe Non bis in idem
Dans une décision rendue le 13 septembre 2017 (n° 15-84823) et publiée au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative, opposant ainsi une résistance à l’application du principe Non bis in idem.
En l’espèce, deux professionnels de la finance,sanctionnés disciplinairement par le CMF le 26 septembre 2001 (décision confirmée par le Conseil d’Etat le 19 mars 2003), pour violation de leurs obligations professionnelles et déontologiques ont, parallèlement été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Nanterre des chefs d'escroquerie, faux et usage. Par jugement en date du 29 novembre 2013, le Tribunal a reconnu les prévenus coupables du délit d'escroquerie. L’ensemble des parties a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt en date du 3 juillet 2015, a constaté l'extinction de l’action publique en relevant que les prévenus avaient déjà été définitivement sanctionnés par le CMF pour les mêmes faits que ceux donnant lieu aux poursuites devant la juridiction pénale, infirmant ainsi la décision rendue par les premiers juges. Le procureur général décidait alors de former un pourvoi en rappelant que le Gouvernement français avait émis une réserve selon laquelle seules les infractions pénales relevant de la compétences des tribunaux statuant en matière pénale devaient être regardées comme une infraction au sens de l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’Homme. Au regard de cette réserve, le CMF ne pouvant pas être considéré comme une juridiction pénale, le principe Non bis in idem ne pouvait faire obstacle à la condamnation pénale.
Cette argumentation est retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui censure l’arrêt attaqué : « … attendu qu'en statuant ainsi, et alors que le Conseil des marchés financiers n'est pas une juridiction pénale au sens de la réserve susvisée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ».
La chambre criminelle écarte donc l’application du principe Non bis in idem en l’espèce au motif que le CMF n’est pas une juridiction pénale. Cette position rejoint celle du CE qui avait déjà affirmé que le CMF n’était pas une juridiction au regard du droit interne ( CE, 3 déc. 1999, n° 207434, Didier).
Mais cette qualification de la Haute juridiction administrative française a déjà été désavouée par la Cour européenne des droits de l’Homme qui considère que : « quelle que soit la qualification qui lui est donnée en droit interne, le Conseil des marchés financiers, selon les critères de sa jurisprudence et la notion autonome qu’elle a d’un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, doit être regardé comme un « tribunal » au sens de ces dispositions. » (27 août 2002, n° 58188/00, Didier c/ France).
En outre, s’agissant de l’existence d’une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne, la Cour européenne considère de manière très cohérente qu’une procédure engagée contre une personne devant un tribunal, bien que qualifiée d’administrative en droit interne, doit s’analyser en une procédure pénale en raison notamment de la nature de l’infraction et de la sévérité de la peine encourue (10 févr. 2009, no 14939/03, Zolotoukhine c/ Russie). Une sanction disciplinaire peut donc elle aussi être de « nature pénale » eu égard à sa sévérité qui lui donne le caractère d’une punition.
Au regard de cette jurisprudence européenne, la décision de la chambre criminelle du 13 septembre 2017, et particulièrement l’affirmation formulée de façon générale, ne manque donc pas de surprendre, et ce d’autant plus qu’elle va à l’encontre d’une tendance générale aujourd’hui, au niveau jurisprudentiel mais aussi législatif. Il s’agit sans doute d’un combat d’arrière garde qui pourra susciter un recours devant la Cour européenne. A suivre donc…
Katrin Deckert
Maître de conférences Université Paris Nanterre