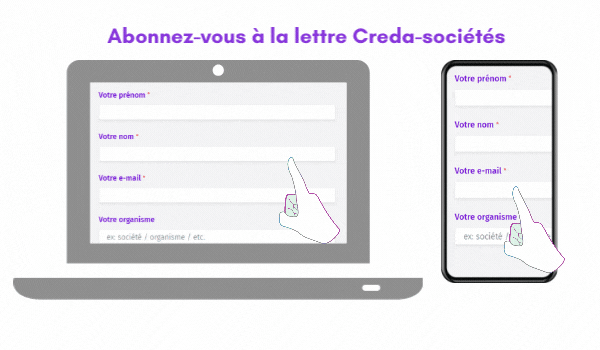La nouvelle raison d'être
Lettre CREDA-sociétés 2019-10 du 3 juillet 2019


Innovation de la loi PACTE du 22 mai 2019, la raison d'être, ou "principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité" suscite, de part les incertitudes qui accompagnent sa mise en oeuvre, un certain nombre d'interrogations.
La loi 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), a été publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019, après sa validation partielle par le Conseil constitutionnel. De nombreux textes d’application sont encore attendus.
Des innovations majeures : la raison d’être et la société à mission.
En droit des sociétés, la double innovation majeure, introduite par l’article 169 de la loi PACTE, réside incontestablement dans la modification des articles 1833 et 1835 du Code civil pour :
- d’une part, retenir une conception élargie de l’intérêt social et,
- d’autre part, offrir aux sociétés une faculté de prévoir dans leurs statuts une « raison d’être ».
Plus précisément, l’art. 1833 du Code civil est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ; et à l’article 1835 du même code est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. ».
Les dispositions du Code de commerce sur la société anonyme sont également modifiées en ce sens par la loi PACTE. Ainsi notamment, en application du nouvel article L. 225-35, alinéa 1 du Code de commerce, le conseil d'administration « détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ; et « prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. ».
Au-delà de cette « raison d’être », le législateur crée par ailleurs aussi un nouveau statut juridique : celui de société à mission (art. 176 de la loi PACTE). Plus précisément, le nouvel article L. 210-10 du Code de commerce dispose qu’une société peut publiquement faire état de sa qualité de société à mission uniquement si elle respecte certaines conditions dont celle tenant à ce que « ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ».
Même si les sociétés, en vertu de la liberté statutaire, pouvaient déjà viser une raison d’être et même si celle-ci reste une simple option, la consécration législative de la notion doit retenir l’attention. Faire référence à une raison d’être n’est pas dépourvue de conséquences juridiques concrètes : l’inscription de la raison d’être dans les statuts impose de s’y conformer (Conseil d’État, 14 juin 2018, n° 394599 et 395021, Avis sur un projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, p. 29, n° 105).
Ainsi, le conseil d’administration et, de manière générale, les dirigeants et les organes sociaux, doivent prendre également en considération la raison d’être de la société dans leurs décisions, voire la défendre, notamment contre les propres associés et/ou investisseurs de la société. Autrement dit, la prise en considération de la raison d’être de la société n’est pas obligatoire, sauf lorsque celle-ci est définie dans les statuts.
Mais concrètement jusqu’où ? Et dans toutes circonstances ? Des incertitudes demeurent.
De nombreuses incertitudes demeurent…
Aux États-Unis, où les entreprises à mission sont très nombreuses (L3C (Low-Profit Limited Liability Company), Benefit Corporation, FPC (Flexible Purpose Corporation), etc.), beaucoup de travaux ont déjà porté sur la raison d’être, qui peut être résumée de la manière suivante :
- ce qui singularise l’entreprise ou la distingue des autres entreprises, et
- ce que l’entreprise apporte à ses clients.
En France, en revanche, la notion de raison d’être est inédite dans la législation et la jurisprudence. A cela s’ajoute l’absence de précision sur le contenu et la portée de la notion de raison d’être par le législateur dans la loi PACTE (« constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité »), même si cette notion a vocation à être précisée au fur et à mesure par la pratique et la jurisprudence.
D’autres questions se posent du reste.
- Pourra-t-on changer la raison d’être, et dans l’affirmative à l’unanimité ou à la majorité nécessaire pour modifier les statuts ?
- Et que se passera-t-il en cas de méconnaissance de la raison d’être (par un organe de la société et/ou ses dirigeants) ? Est-il possible d’appliquer les règles concernant le dépassement de l’objet social ?
- La raison d’être sera-t-elle opposable aux tiers ? Elle figurera certes dans les statuts, mais on sait que la seule publication des statuts est insuffisante pour rendre le tiers de mauvaise foi. La raison d’être devra-t-elle alors être publiée ?
De manière générale, quel est le rapport entre objet social et raison d’être ?
Il apparaît ainsi que la raison d’être introduite par la loi PACTE est source de nombreuses incertitudes ; elle ne manquera pas de susciter des questions, et peut-être un contentieux qui pourrait être non négligeable. Les plus fortes incertitudes tiennent au pouvoir d’interprétation du juge judiciaire en présence de notions très souples : les juges sont susceptibles d’avoir un pouvoir d’intervention accru dans la gestion de la société, à travers notamment la raison d’être (et plus généralement, dans toutes les sociétés, l’intérêt social élargi).
Cela n’empêche pas certaines grandes sociétés de franchir le pas. Ainsi, la société mutuelle d’assurance MAIF, qui compte devenir une société à mission dès 2020, a adopté une raison d’être. Il en va de même du Crédit Agricole dont la raison d’être est d’« agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société », du Carrefour (« la transition alimentaire »), de l’Atos (« mission de contribuer à façonner l’espace informationnel »), ou encore de Veolia (« ressourcer le monde »)…
Katrin DECKERT
Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre