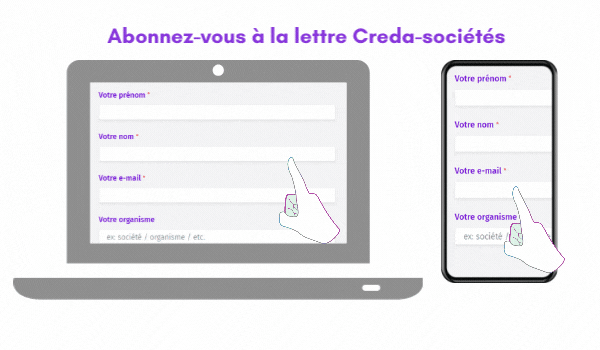Poursuite des fonctions sociales au terme du mandat : quelles conséquences pour le dirigeant ?
Lettre CREDA-sociétés 2021-11 du 16 juin 2021


Lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.
L’arrêt rendu le 17 mars 2021 par la chambre commerciale de la Cour de cassation est une bonne occasion de revenir sur quelques tendances récentes de la jurisprudence s’agissant de la nature des fonctions des dirigeants sociaux.
En l’espèce, une présidente de SAS avait été désignée, le 26 juin 2012, pour une durée de trois ans. Les statuts stipulaient « que la révocation du président ne pourrait intervenir que pour un motif grave, par décision collective unanime des associés autres que le président, et que toute révocation intervenant sans qu’un motif grave ne soit établi ouvrirait droit à une indemnisation du président. » Bien qu’une assemblée fût réunie trois jours avant l’arrivée du terme du mandat social, elle ne se prononçait pas sur son renouvellement. Finalement, une « assemblée générale » du 22 mars 2016 décidait « de ne pas [la] renouveler [...] dans ses fonctions de présidente à compter de ce jour ». Soutenant qu’elle avait fait l’objet d’une révocation fautive et que cette mesure était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, la présidente assignait la société en paiement de l’indemnité statutaire et de dommages-intérêts.
Dans son pourvoi contre l’arrêt ayant rejeté ses demandes, la présidente soutenait deux arguments.
Elle prétendait d’une part que son mandat social avait tacitement été reconduit avec l’accord de l’associé unique et que faute pour la société d’avoir justifié, conformément aux statuts, d’un motif grave pour ne pas la renouveler dans ses fonctions, elle avait fait l’objet d’une révocation abusive et était fondée à obtenir paiement de l’indemnité prévue par les statuts.
Elle soutenait d’autre part que sa révocation était brutale et vexatoire au motif, notamment, qu’elle avait été dans les heures suivant sa révocation, alors qu’elle était au service de la société depuis 14 ans, invitée à reprendre ses affaires et à quitter l’entreprise sous l’escorte de l’huissier ayant assisté à l’assemblée.
Ces deux moyens sont rejetés.
On passe rapidement sur la révocation vexatoire dont l’enjeu était probatoire. Rappelons simplement qu’il n’y a pas que la révocation qui ne doit pas intervenir dans des circonstances vexatoires (par. ex. pour le non-renouvellement, Com. 17 déc. 2002, n°98-21918).
Il faut être en revanche plus attentif à la solution qui, sous une formulation de principe, retient que « Lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit. »
L’absence de renouvellement tacite des fonctions de dirigeant
C’est la première fois à notre connaissance, ce qui explique probablement la publication de l’arrêt, que la Haute juridiction décide que le mandat social à durée déterminée cesse de plein droit à l’arrivée de son terme de telle sorte que, non seulement le renouvellement doit être exprès, mais plus encore, que le dirigeant qui continue de diriger la société ne peut se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions.
D’abord, bien que « nouvelle » et rendue dans une SAS, cette solution ne surprend pas et doit certainement être étendue à tout mandat social à durée déterminée. Plusieurs cours d’appel avaient déjà statué en un sens proche (pour le gérant de SARL : Versailles, 12 sept. 2002, RG n°00/7416 ; pour le membre d’un directoire de SA : Paris, 18 oct. 2018, RG n° 16/03087). La solution est d’ailleurs sous-entendue pour certains mandataires sociaux puisque le législateur prévoit parfois un filet de sécurité pour éviter, précisément, le couperet de la cessation de plein droit des fonctions (C. com., art. R. 225-15 et R. 225-41). Il a en outre été jugé, par deux fois, qu’un dirigeant n’a pas de droit au renouvellement de ses fonctions (pour le gérant de SARL : Com., 17 déc. 2002, préc. ; pour l’administrateur : Com. 7 nov. 1989, n°88-11381).
Ensuite, l’arrêt du 17 mars 2021 témoigne de ce que la Cour de cassation adopte une conception institutionnelle, ou, moins « contractualiste » de la relation dirigeant-société.
Cela vaut dans les SAS pour lesquelles « seuls les statuts […] fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (Com., 25 janv. 2017, n°14-28792) et ce, même si la rémunération peut être assujettie à la procédure des conventions réglementées, sauf lorsqu’elle est procède d’une décision sociale (pour une décision collective : Com. 4 nov. 2014, n° 13-24889).
Cela vaut plus largement puisqu’il a été décidé que « les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant », titulaire d’un pouvoir légal de représentation (Com., 18 sept. 2019, n°16-26962 ; rappr. Com., 9 déc. 2020, n°18-24730, écartant l’application de C. civ., art. 1992, al. 2, au dirigeant poursuivi en comblement de l’insuffisance d’actif).
Il est vrai que l’on pourrait voir dans l’arrêt du 17 mars 2021 une application de la règle, de droit commun, selon laquelle « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat » (C. civ., art. 1212, al. 2) et qui concerne aussi le mandat de droit commun.
Il reste que la Cour ne parait pas mobiliser l’article 1215 du Code civil selon lequel « lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction », alors même que cet article a vocation, lui-aussi, mutatis mutandis, à régir tout acte juridique (C. civ., art. 1101-1).
En tous les cas, le fait que la SAS soit à associé unique n’y change rien : le renouvellement suppose de respecter les exigences légales ou statutaires d’expression de la volonté sociale, qui ne peut se déduire de l’attitude de l’associé unique et suppose une décision expresse.
De ce point de vue, la solution se comprend. Il convient d’éviter que ne se généralise une autre tendance, inverse, qui admet que les associés puissent, par leur consentement unanime, en dehors des processus et formes du droit des sociétés, déroger à une clause des statuts (Com., 12 mai 2015, n°14-13744 et sur renvoi Com., 29 janvier 2020, n°18-15179 ; rappr. Com., 18 mars 2020, n°18-07010).
La qualification de dirigeant de fait
C’est le second intérêt de l’arrêt : le dirigeant, dont les fonctions cessent de plein droit et qui en poursuit l’exercice, sans être expressément renouvelé, devient dirigeant de fait.
Sévère, la solution doit inciter à l’anticipation, soit par les statuts (durée indéterminée ou renouvellement tacite), soit de la part du dirigeant. En l’occurrence, on comprend qu’il appartenait à la présidente de provoquer une décision, soit pour organiser sa succession, soit pour solliciter le renouvellement de ses fonctions.
Cela peut s’expliquer : le dirigeant a souvent la maîtrise de la convocation et donc de l’ordre du jour des organes en charge de le nommer. La solution serait-elle différente si les statuts offraient à l’associé unique un pouvoir d’auto-saisine ? Ce n’est pas certain.
Une fois la qualification retenue, la Cour en tire certaines conséquences.
D’abord, devenue dirigeant de fait, l’intéressée n’est plus en fonction et ne peut faire l’objet d’une révocation ou prétendre que le non-renouvellement est, de fait, une « révocation ». Ajoutons qu’elle ne saurait, non plus, démissionner. L’associé ou les associés peuvent a priori constater à tout moment la fin des fonctions, sous réserve de ne pas le faire dans des conditions brutales ou vexatoires.
Ensuite, n’étant pas révoquée, elle ne peut revendiquer le bénéfice des statuts (l’indemnité de révocation ici). Comme tout dirigeant de fait, elle devra souffrir les inconvénients de la qualité (comblement de l’insuffisance d’actif et incrimination d’abus des biens ou du crédit, singulièrement), sans profiter des avantages du statut (par ex. sur l’impossibilité d’invoquer la prescription triennale applicable aux seuls dirigeants de droit : Com. 12 avr. 2016, n° 14-12894, dans une SA).
Les associés et la société (en partie), comme les tiers, demeurent « protégés ». D’un côté, le dirigeant de fait doit respecter la loi, les statuts et l’intérêt social. De l’autre, sauf cas exceptionnel (C. com., art. L. 123-9, dern. al.), « la société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes [chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société], tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées. » (C. com., art. L. 210-9, al. 2).
Julien DELVALLEE
Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay